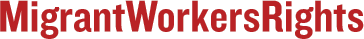Les travailleurs agricoles étrangers, une main-d’oeuvre captive d’un système - Bulletin de l’OIRD 8/1
This document is a key resource
- Date
2012
- Authors
Jill Hanley, Sonia Ben Soltane, Paul Eid, Jah-Hon Koo, Marie Le Ray, André Jacob, and Sid Ahmed Soussi
- Abstract
TABLE DES MATIÈRES
Présentation 3
L'expansion des « programmes des travailleurs migrants temporaires » 5
et leurs effets pervers sur la précarisation du travailEntre dérèglementation du travail et racisme : 9
les travailleuses et travailleurs étrangers « temporaires » au CanadaLes programmes des travailleurs étrangers temporaires au Canada : 13
Une arme d’exploitation massive?Les travailleurs agricoles étrangers, une main-d’oeuvre captive d’un système 17
La situation des travailleurs migrants temporaires : 20
au crible des enjeux de citoyenneté et de justice sociale*********************************************************
p.3 : CONTRE-JUSTIFICATION. FAUSSE PRÉMISSE. L’argument selon lequel la main-d’œuvre locale ne veut pas accomplir les travaux pour lesquels on fait appel à la main-d’œuvre étrangère est une fausse prémisse. En fait, les citoyens canadiens ne veulent pas se plier aux conditions qu’imposent les entreprises qui privilégient la main-d’œuvre immigrante temporaire. Les entreprises veulent pouvoir compter sur une main-d’œuvre peu coûteuse, disponible en tout temps, soumise, non organisée collectivement, voire sans droits.
p.18 CONTRE-JUSTIFICATION : Les cas d’abus extrêmes et de violations des droits des travailleurs sont loin d’être majoritaires […]. On peut imaginer que, si le lien fixe avec l’employeur est supprimé, ces [bons] employeurs continueront de bien traiter leur main-d’œuvre et les travailleurs ne leur feront pas défaut. En revanche, si la main-d’œuvre gagne en mobilité et peut choisir son employeur, les employeurs irrespectueux, dédaigneux de leur main-d’œuvre, perdront leurs travailleurs. Pour ne pas «fermer boutique», ils seront sans doute contraints de s’informer sur les droits des travailleurs et d’en tenir dûment compte (Gayet, 2011, p.92).
- Series title
Bulletin de l’Observatoire international sur le racisme et les discriminations
- Responsible institution
Observatoire international sur le racisme et les discriminations
- Notes
Cette main-d’œuvre corvéable doit, particulièrement dans le cas de la main-d’œuvre agricole et des secteurs connexes(abattoirs, par exemple) de même que dans le cas des travailleuses domestiques, respecter des conditions d’embauche strictes : hébergement sur les lieux de travail, salaire minimum, pas de cumul d’ancienneté, soumission à de longues heures de travail, aucune sécurité, menace de rapatriement, retrait des documents personnels dans certains cas, etc. (p.3).
Cette discrimination systémique signifie que les travailleurs migrants temporaires n’ont pas droit à l’aide juridique, à l’aide
sociale, à l’instruction publique ou aux programmes de soutien à l’intégration des immigrants (apprentissage de la langue,
etc.). Ils sont aussi exclus de certaines dispositions du Code du travail, de la Loi sur les normes du travail, de la Loi sur la santé
et la sécurité du travail et de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnellesSouvent, les travailleurs se retrouvent dans des ghettos fermés ou sont regroupés entre gens de diverses origines et langues
afin de limiter au minimum les communications entre eux. Certains employeurs se permettent même de « vendre » les
services de leurs employés à d’autres entreprises afin de maximiser leurs profits. Cette forme d’esclavage sous la version
moderne du capitalisme sauvage n’a pas sa place dans une société démocratique et commande des changements rapides. (p. 4 )
e. Notons par exemple la fédération syndicale
des TUAC qui a investi des ressources matérielles et financières
conséquentes pour soutenir les tentatives de syndicalisation
des travailleurs saisonniers dans plusieurs
provinces du Canada. C'est ainsi qu’on a pu voir apparaître
au Manitoba en novembre 2008 la première convention
collective signée par des travailleurs agricoles saisonniers.
En Ontario, là où les syndicats agricoles ont été longtemps
interdits, ces efforts ont permis, à la suite de plusieurs
recours juridiques, de faire déclarer par la cour d'appel de
l'Ontario que l'interdiction législative des syndicats
agricoles est une violation du droit à la négociation collective
garanti par la Charte canadienne des droits et liberté.
Toutefois, ce ne fut là qu’un répit puisque la Cour suprême
du Canada statuera en avril 2011 dans une direction opposée,
donnant raison à la province de l’Ontario de refuser
aux travailleurs agricoles le droit à la négociation collective
(Ontario c Fraser, 2011).
Que dire également des efforts déployés par les TUAC au
Québec, où la Commission des relations du travail (CRT) a
rendu un jugement favorable à une demande d'accréditation
syndicale d'un groupe de travailleurs agricoles saisonniers
et a ainsi ouvert une brèche. En effet, en avril 2010, la
CRT ouvre la porte à la syndicalisation des milliers de travailleurs
étrangers embauchés pendant la saison des récoltes
dans les fermes québécoises. Elle accorde le droit de se
syndiquer à six travailleurs mexicains employés par la ferme
L’Écuyer et Locas de la région de Mirabel dans les Laurentides
(TUAC, section locale 501 c L’Écuyer et Locas, 2010).
Cette décision est toutefois contestée (L’Écuyer c Côté,
2010; Québec c TUAC, 2011) et les deux requêtes en révision
judiciaire sont dites « continuées sine die », c’est-à-dire sans
fixer de dates précises pour la suite. (p7)
Comme le font remarquer certains chercheurs (Guillon et al.,
1999; Walia, 2010), une des contradictions les plus apparentes
dans le phénomène de la mondialisation est celle
entre, d'une part, l'adoption de politiques facilitant la libre
circulation des marchandises et, d'autre part, les mesures de
restriction de plus en plus importantes affectant la libre
circulation des personnes.Ce constat appelle deux remarques. La parade potentielle
contre ce phénomène et les résistances permettant d’en
réduire les impacts sociaux et économiques négatifs ne
peuvent être renvoyées aux seules organisations syndicales,
cela pour deux raisons. La première est liée aux difficultés,
soulignées plus haut, auxquelles se heurte l'action syndicale
locale déjà fragilisée par la désagrégation des rapports collectifs
du travail et surtout par son incapacité d’agir à l’échelle
transnationale, comme le font les stratégies des entreprises.
La deuxième renvoie au fait qu’à cette échelle, précisément,
l'action syndicale internationale n'a que très peu de normes
sur lesquelles elle peut baser son action (Soussi, 2010b). Trois
conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT)
peuvent constituer des recours potentiels. La Convention sur
les travailleurs migrants (C-97) (datant de 1949), la Convention
internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille (adoptée par
l'ONU en 1990, entrée en vigueur en 2003), et la toute
nouvelle Convention concernant le travail décent pour les
travailleuses et travailleurs domestiques (C-189) (adoptée par
l'OIT en 2011). Rappelons que le Canada n'a encore ratifié
aucune de ces conventions (Epale et al., 2006).(p7)
Les programmes de travail temporaire
canadiens constituent en ce sens une formule renouvelée
de « l’utilitarisme migratoire » : l’employeur et son État
tirent ainsi bénéfice de la force de travail sans avoir à
prendre en charge l’intégration sociale du travailleur (Morice,
2004; Beaugrand, 2010). Or, comme nombre de rapports et
d’études le montrent, cela ne peut se faire qu’aux dépens de
l’égalité des droits et des normes de travail (Le Ray, 2011) (p9).
À un pôle se trouvent les travailleurs étrangers sous statut
légal précaire, mais a priori « désirables » et « intégrables ».
On leur accorde donc le droit et les moyens de faire venir leur
famille, de changer d’employeur au besoin, de choisir leur
lieu de résidence et d’intégrer éventuellement le système
d’immigration. À l’autre pôle se trouvent les travailleurs étrangers
« non désirables » (Stasiulis et Yuval-Davis, 1995).
Ceux-ci ne bénéficient d’aucun de ces droits et sont exclus,
de manière permanente, des procédures d’accession à la
résidence permanente. Autour de quels critères, de quels
mécanismes et au nom de quoi sont alors organisées cette
infériorisation et cette discrimination de certains travailleurs
étrangers? Quels en sont les effets? (p9)- File Attachments
- Economic sectors
Agriculture and horticulture workers and General farm workers
- Content types
Policy analysis
- Geographical focuses
Quebec and National relevance
- Spheres of activity
Political science, Sociology, and Social work
- Languages
French